Il n’existe pas de rayon „musique triste“ et pourtant il pourrait contenir un infini bac à disques. Il y a les paroles atrabilaires, les mélodies anéanties ou ces parties instrumentales qui piquent le palpitant, mais aussi un élément plus ésotérique que l’on nommera, de façon abstraite, „l’atmosphère“, où la vie débouche sur la musique. Nous parlons là de ces disques qui renvoient à des conditions d’enregistrement plombantes, à l’instar du „Rock Bottom“ de Robert Wyatt, qui, se retrouvant paralysé à vie suite à une chute de plusieurs étages, ne peut plus jouer de la batterie. Ou alors ceux qui font office de testaments, donc d’adieux déchirants – pour prendre les cas récents d’icônes, „You Want It Darker“ de Leonard Cohen et „Blackstar“ de David Bowie. Et là, „dernier album“ se lit au sens littéral. Mais back to the nineties.
En 1995, soit un an après le suicide de Kurt Cobain, les héros grunge The Smashing Pumpkins sortent un album sur la mort, qui se veut, par définition, ultime, avec un titre non moins définitif, „Mellon Collie And The Infinite Sadness“. Pas un mais deux disques, oui, comme un coup de massue ou comme l’album blanc des Beatles, ce qui ne veut pas dire que „Mellon Collie“ est l’album noir des Smashing Pumpkins – spoiler: pour cela, il faut attendre le suivant, „Adore“. Frank Olinsky, à qui l’on doit le logo de MTV, se charge de l’artwork: la femme qui sort de l’étoile sur la couverture est un patchwork entre une peinture de Raffaello pour le corps („Sainte-Catherine d’Alexandrie“) et une autre de Jean Baptiste Greuze pour le visage („Le Souvenir“); avant la dématérialisation, une pochette pouvait encore plus orienter l’oreille, ou se poser en trompe-l’œil. L’imagerie de „Mellon Collie“, en l’occurrence, de contraster avec l’angoisse amère qui se loge chez le leader Billy Corgan et qui éclabousse les compositions, même si celles-ci sont parfois traversées par des trouées lumineuses, oserait-on dire pop. Dès les premières notes de piano, flottantes, sur le titre éponyme instrumental ou dès la vraie entrée „Tonight, Tonight“, morceau qui fait l’effet d’un crépuscule au bout d’un tunnel, le disque s’écoute comme au cinéma se regarderait, les yeux écarquillés, une fresque existentielle. Il s’agit là d’un album copieux, généreux, le terme „infinite“ est juste, comme s’il y avait, à la fin des mots, on ne sait combien de points de suspension. Pour parler en chiffres: on compte 28 chansons au total, sachant que 57 ont été, initialement, mises en boîte. Corgan voulait que le disque soit élaboré comme s’il s’agissait du dernier façonné par le groupe.
De la rage au spleen
„Mellon Collie“, c’est un cri sans fioritures, quand bien même l’enrobage se révèle soigné, c’est une immersion spontanée dans les filets du tourment, un best of du pire de ce qui ne cesse de ronger l’âme égratignée. Et de repartir de zéro. Extrait de „Zero“, justement: „Intoxicated with the madness/I’m in love with my sadness.“ Le chanteur a de la tristesse à vociférer et de la rage à pleurer. James Iha semble gratter, à la place des cordes de guitare, ses veines. La basse de D’Arcy Wretzky est pesante. Les baguettes sur la batterie de Jimmy Chamberlain sont des poings qui s’écrasent sur un sac de frappe. L’énergie du désespoir? C’est ce qui s’appelle tout donner, surtout quand on n’a rien à perdre. En termes de genres et de fusions, via la production de Billy Corgan en personne, mais aussi de Flood et d’Alan Moulder (les deux ayant travaillé avec Depeche Mode et Nine Inch Nails), le disque mixe, dans un chaudron éruptif, métal psychédélique braillard, rock baveux nasillard, embardées hard, ballades ou berceuses pour calmer les cauchemars, indus pour pogos solitaires, incursions baroques, séquenceur, loops et samples de batterie même. Jusqu’à „Here Is No Why“, où Billy Corgan évoque la mort de son ami Kurt Cobain. La foule torturée répond présent: „Mellon Collie“ est le double album le plus vendu des nineties. Pendant ce temps, alors que le disque est dédié à l’humoriste américain Bill Hicks, il n’y a pas de quoi rire non plus avec „The Bends“ de Radiohead. La fin de siècle est-elle celle du chaos?
Un autre question s’impose: que faire après ce fastueux „Mellon Collie“? En 1998, la souffrance, tenace, persiste. Jonathan Melvoin, claviériste sur la tournée Mellon Collie, meurt d’une overdose, et le groupe se sépare de Jimmy Chamberlain, le batteur étant devenu ingérable, à cause de sa dépendance sévère à l’héroïne. Il est remplacé par la boîte à rythmes. Le changement de tonalité surprend avec „Adore“, qui adopte un profil bas. Le tempo est ralenti. Les riffs électriques, écrabouillés, sont rangés dans un placard verrouillé. S’il y a un pied dans le grunge, il s’avère lointain sinon avorté: „Daphne Descends“ est, à l’origine, composé pour l’album „Celebrity Skin“ de Hole, ce qui ne sera pas le cas suite à des conflits entre Billy Corgan et Courtney Love. La pochette sombre oriente l’auditeur: c’est le retour au son new wave, par où le groupe a démarré. Et, plus largement, le revival du gothique au rayon grand public, avec, en parallèle, les succès de Marilyn Manson et Placebo.
„Adore“ est le premier album synthétique des Smashing Pumpkins, avec, toujours, cette voix écorchée de Corgan, qui, à elle-seule, renvoie au rock. Si la touche électronique anticipe le disque à venir, „Machina – The Machines Of God“, „Adore“ incarne la vulnérabilité dans toute sa grandeur, par le minimalisme et la résignation. Le NME le désigne comme étant l’un des disques les plus tristes de tous les temps. Voici donc l’album qui justifierait vraiment le titre et le geste du précédent, „Mellon Collie“. Et la fameuse phrase de Victor Hugo, comme quoi la mélancolie, c’est le bonheur d’être triste? Non: il n’y a pas de complaisance dans les méandres de la douleur mais la capacité inouïe ici à en extirper des chansons somptueuses („Behold! The Nightmare“, „For Martha“ ou même „Perfect“ en guise de tube parfait). Un morceau comme „Tear“ est suffisamment éloquent. Et une conclusion au piano désaccordé telle que „Blank Page“, en fade out, écrase les derniers mots de Corgan, „You are a ghost of my indecision/No more little girl“, qui tracent alors d’autres points de suspension. La tristesse n’a pas de fin.
Lisez aussi:
Portrait de Kiki Wong, nouvelle guitariste en tournée des Smashing Pumpkins


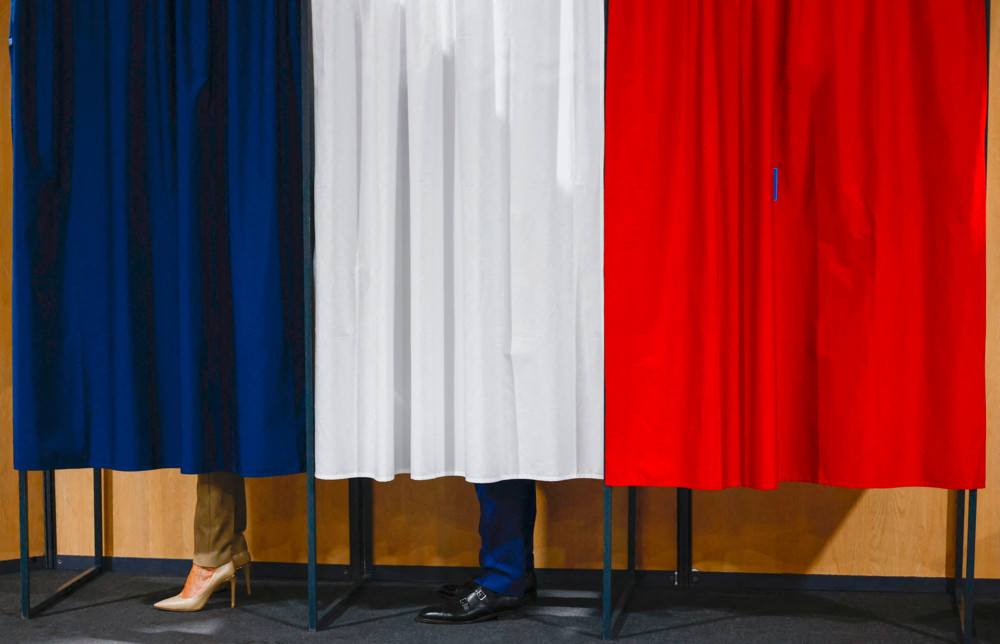


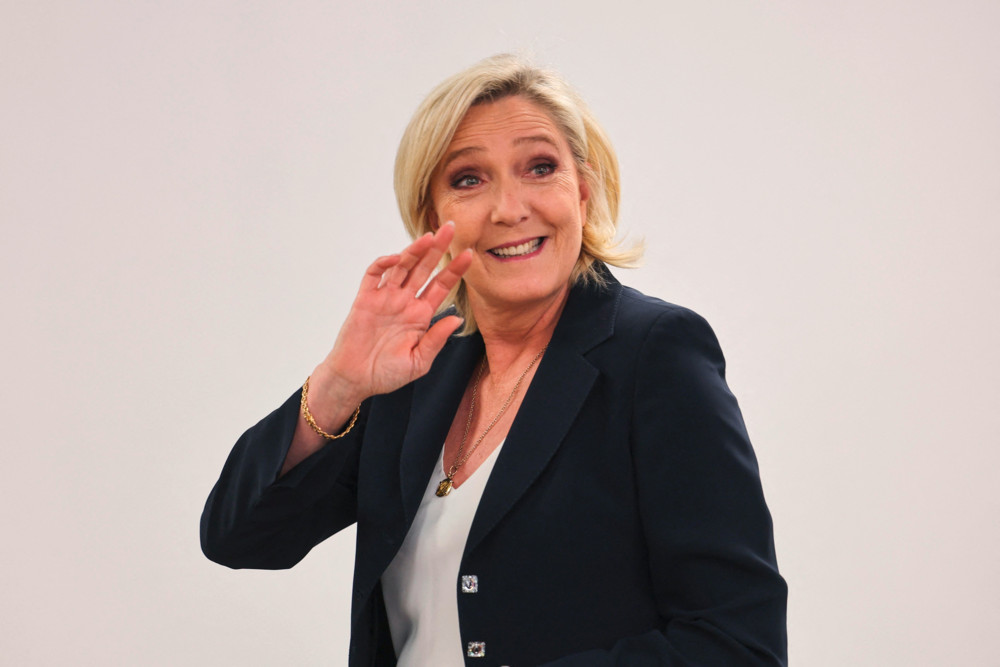


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können